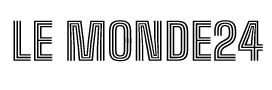Le Conseil constitutionnel censure des dispositions de la loi sur la sécurité des transports
Une décision marquante a été rendue par le Conseil constitutionnel, qui a annulé certaines parties d’une récente loi relative à la sécurité dans les transports. Ce texte, adopté le mois dernier, stipulait que les forces de sécurité de la SNCF et de la RATP avaient le pouvoir de « contraindre » toute personne troublant l’ordre public à quitter les gares, stations ou véhicules. Selon les juges constitutionnels, une telle prérogative accordée à des agents privés va à l’encontre de la Constitution.
Cette décision fait suite à une saisine par des députés de divers partis, parmi lesquels La France insoumise, les écologistes et le Parti socialiste. Le Conseil a précisé que, bien que ces agents aient le droit de « refuser l’accès » à ces espaces, ils n’ont pas le droit d’exercer une contrainte physique sur les personnes qui refusent de se conformer à leurs directives. L’argument avancé par le Conseil souligne que toute mesure de contrainte doit être réservée aux autorités de police.
Les ajustements apportés par le texte de loi
Le projet de loi, qui a suscité un grand intérêt parmi les professionnels du secteur, inclut aussi des dispositions favorisant l’utilisation de caméras-piétons par les contrôleurs ainsi que la possibilité pour les forces de sécurité, à savoir la Sûreté ferroviaire pour la SNCF et la GPSR pour la RATP, de procéder à des fouilles sans autorisation préalable des préfets. De plus, ces forces peuvent intervenir aux abords des gares, ces mesures ayant été validées par le Conseil constitutionnel.
La censure des caméras de surveillance
En revanche, le Conseil constitutionnel a également invalidé l’expérimentation, à Mayotte, de caméras embarquées sur les bus scolaires. Selon les juges, le déclenchement de ces caméras n’était pas conditionné à la survenance d’un incident, ce qui aurait permis un usage généralisé de ces dispositifs capables de capturer les images d’un grand nombre d’individus, y compris des mineurs. Cela soulève des préoccupations majeures en matière de respect de la vie privée.
Les juges ont résolu que ce cadre législatif, tel qu’il était formulé, violait le droit à la vie privée, en ne fixant pas de limites claires sur l’utilisation de ces caméras. En conclusion, le Conseil a souligné que la surveillance à grande échelle sans encadrement légal approprié ne pouvait être acceptée.
Des articles jugés comme cavaliers
Le Conseil a également exclu plusieurs articles considérés comme « cavaliers », c’est-à-dire n’ayant pas de lien suffisant avec le texte initial de la loi. Parmi eux, une disposition visant à doter les agents de la SNCF, déjà armés, de pistolets à impulsion électrique, communément appelés Taser. Une autre disposition concernait la prolongation d’une expérimentation de dispositifs de vidéosurveillance algorithmique lors de grands événements, un système déjà mis à l’épreuve durant les préparatifs des Jeux olympiques de Paris en 2024.
Ces décisions soulèvent d’importantes questions sur les enjeux de sécurité publique et les droits individuels. La censure du Conseil constitutionnel rappelle l’importance cruciale des garanties légales dans l’application des lois, particulièrement lorsque celles-ci touchent à la liberté individuelle et au respect de la vie privée. Les prochains débats sur les travaux législatifs liés à la sécurité dans les transports devront impérativement tenir compte de ces principes pour éviter de nouvelles contestations. En ce sens, les instances gouvernementales doivent sans aucun doute revisiter ces dispositifs afin de concilier sécurité et respect des droits fondamentaux des citoyens.
Avec ces développements, le paysage législatif autour de la sécurité dans les transports est en pleine mutation, incitant à une réflexion approfondie sur nos priorités collectives en matière de sécurité et de libertés publiques.