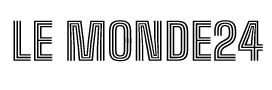Le secteur textile : un impact environnemental sous-estimé
Lorsqu’il est question des principales sources de pollution à l’échelle mondiale, l’industrie pétrolière ou celle de l’agroalimentaire sont généralement en tête de liste. Cependant, l’industrie textile, souvent négligée, joue un rôle tout aussi décisif dans la dégradation de l’environnement. Sa consommation d’eau est particulièrement élevée, en particulier pour la culture du coton. Pour produire un kilogramme de coton, il faut environ 10 000 litres d’eau !
En outre, la fabrication de textiles implique l’utilisation de produits chimiques variés, allant des pesticides employés dans la culture du coton aux teintures et autres agents de blanchiment. Ces pratiques portent atteinte à la qualité des sols et des eaux, avec des conséquences néfastes pour la santé humaine et la biodiversité. De plus, durant son cycle de vie, un vêtement génère d’importantes émissions de gaz à effet de serre. Le transport de ces produits, souvent fabriqués loin des zones de consommation, ne fait qu’aggraver cette empreinte carbone. Pour couronner le tout, les textiles synthétiques, comme le polyester, libèrent des microparticules de plastique lors des lavages, contribuant ainsi à la pollution des océans et à la contamination de la chaîne alimentaire.
Malheureusement, une part infime des textiles est recyclée. La majorité finit soit incinérée, soit jetée dans des décharges, entraînant ainsi une accumulation de déchets énorme.
Les changements en France d’ici 2025
Un récent accord au sein de l’Union Européenne a révélé l’intention de mettre en place de nouvelles directives visant à réduire les déchets textiles sur son territoire. Cet accord stipule que les États membres doivent instaurer des systèmes de responsabilité élargie des producteurs (REP). Ainsi, les producteurs, importateurs et distributeurs de vêtements, de linge de maison et de chaussures auront la charge de la gestion des déchets de leurs produits en fin de vie, prenant en charge les coûts liés à leur collecte, leur tri et leur recyclage.
En France, des initiatives ont déjà été lancées. La loi AGEC, adoptée en 2020, offre un cadre pour lutter contre le gaspillage et favoriser l’économie circulaire. Parmi les mesures adoptées, l’interdiction de la destruction des invendus vise à éviter l’incinération des produits non écoulés, en obligeant les producteurs à offrir ou à recycler ces articles.
Avant cette année, les textiles n’étaient pas inclus dans le tri à la source. Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle catégorie dédiée aux textiles a été créée, et les professionnels doivent mettre en place des dispositifs spécifiques de tri. Il leur est désormais interdit de mélanger les déchets textiles avec d’autres types de déchets.
Cependant, il est à noter que pour le moment, cette loi ne concerne que les entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions d’euros et détenant au minimum 10 000 unités sur le marché. L’objectif est d’élargir progressivement ces critères pour inclure davantage d’entreprises dans cette démarche.
Agir à l’échelle individuelle
Pour les consommateurs, bien que jeter des textiles à la poubelle ne soit pas encore passible d’amende, il est recommandé de privilégier le réemploi et le recyclage. Plusieurs alternatives écoresponsables s’offrent à eux.
Il est possible de faire des dons à des organisations telles qu’Emmaüs, la Croix-Rouge ou le Secours Populaire, qui récupèrent des textiles, même usagés, pour les redistribuer ou les vendre à bas prix. Plus de 47 000 points de collecte sont disponibles dans plusieurs communes, souvent gérés par Le Relais ou Refashion, où l’on peut déposer des vêtements, chaussures et linge, même en mauvais état (hormis s’ils sont souillés ou mouillés).
Pour ceux qui préfèrent revendre, des plateformes de vente en ligne comme Vinted ou Leboncoin permettent de donner une nouvelle vie aux articles en bon état tout en réalisant un petit profit. Les friperies offrent également la possibilité de vendre des vêtements de qualité avec une commission ou un achat direct. Avant de jeter un vêtement, il peut être judicieux d’envisager des options telles que l’upcycling ou la réparation pour prolonger sa durée de vie.
Une consommation plus consciente
Au-delà des réglementations imposées, ces lois visent également à éveiller la conscience des producteurs et des consommateurs face aux enjeux environnementaux liés à l’industrie textile. La loi AGEC a introduit en 2022 de nouvelles règles en matière d’étiquetage, obligeant les producteurs, importateurs et distributeurs à mettre en avant les caractéristiques environnementales de leurs produits. Cela inclut des éléments tels que la présence de microfibres et le pourcentage de matières recyclées dans les emballages et produits.