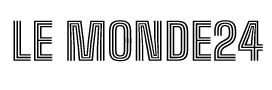Préparatifs pour le Ramadan : un contexte alimentaire préoccupant
Le mois sacré de Ramadan approche à grands pas, et avec lui, des sentiments mêlés de joie et d’inquiétude parmi les ménages marocains. Bien que la tradition d’accueillir cette période spéciale soit ancrée dans la culture, le contexte économique actuel soulève des préoccupations majeures, particulièrement en ce qui concerne l’alimentation. Un rapport récemment publié par le Haut commissariat au plan (HCP) révèle des changements significatifs dans le modèle de consommation des Marocains entre 2014 et 2022, soulignant l’ampleur des inégalités alimentaires.
Des évolutions dans les comportements alimentaires
Les tendances alimentaires au Maroc montrent une disparité marquée entre les groupes sociaux. Les ménages à faible revenu continuent de favoriser les produits de première nécessité, tandis que les classes plus aisées augmentent leurs dépenses pour des repas pris à l’extérieur. Cela illustre une fracture de plus en plus évidente dans les habitudes de consommation.
La part des dépenses allouées aux céréales a légèrement diminué, passant de 16% à 12,5%, ce qui démontre une volonté de diversifier l’alimentation, notamment parmi les classes moyennes et supérieures. En parallèle, la consommation de légumes frais a connu une hausse passant de 8% à 10,2%, témoignant d’une sensibilisation croissante à l’importance d’une alimentation plus saine.
Le repas à l’extérieur : un luxe en pleine expansion
Un fait marquant est l’augmentation presque spectaculaire de l’intérêt pour les repas pris à l’extérieur. Ce chiffre a presque doublé en seulement huit ans, passant de 6,5% en 2014 à 12,8% en 2022. Cette tendance est particulièrement forte dans les zones urbaines, où le rythme de vie rapide favorise la restauration hors domicile.
Quant à la consommation de viande et de poisson, celle-ci reste très inégale, les ménages riches y consacrant une plus grande part de leur budget. Cela souligne davantage les disparités alimentaires existantes, où les ménages à revenu modeste allouent une plus grande partie de leurs ressources aux céréales et aux légumes.
Des inégalités persistantes selon le niveau de vie
Les écarts alimentaires entre les différentes couches sociales sont frappants. Les foyers moins favorisés dépensent en moyenne 14,6% de leur budget pour les céréales, tandis que les familles riches ne consacrent que 10,6% à ce même poste. Pour les légumes, ces chiffres sont respectivement de 14,8% contre 7%. En revanche, les familles aisées investissent davantage dans les produits laitiers, la viande et le poisson, symboles d’un statut social et d’un confort matériel.
L’accès à des produits de qualité, qu’ils soient transformés ou importés, demeure limité pour de nombreuses familles modestes, exacerbant ainsi les inégalités nutritionnelles.
Impact de la crise sur le niveau de vie
L’analyse des changements de niveau de vie révèle un creusement des inégalités au sein de la population. Entre 2014 et 2019, une légère amélioration des conditions de vie a été observée, mais la période suivante, marquée par la pandémie et l’inflation, a entraîné une régression générale. Les 20% les plus riches ont vu leur niveau de vie diminuer de 1,7%. Ce groupe a néanmoins pu ajuster ses habitudes sans grandes modifications.
À l’opposé, les 20% les plus pauvres ont subi une chute de -4,6%, mascéant leur accès à de nombreux aliments et les forçant à se tourner vers des options moins coûteuses. La classe moyenne, également touchée, a vu son niveau de vie baisser de 4,3%, réduisant sa capacité à jongler entre qualité et coût alimentaire.
Disparités régionales et défis d’accès
Les disparités économiques régionales ont également un impact significatif sur l’accès à une alimentation variée. Des régions comme Dakhla-Oued Ed-Dahab bénéficient d’un niveau de vie plus élevé grâce à des activités économiques diversifiées. En revanche, dans les zones rurales ou les régions isolées, le manque d’infrastructures et les fluctuations des prix des denrées alimentaires restreignent l’accès à une alimentation équilibrée.
Vers des solutions pour atténuer les inégalités alimentaires
Face à ce déséquilibre manifeste, il est crucial d’envisager des solutions pour réduire les inégalités. Des experts recommandent de renforcer les politiques publiques afin d’améliorer l’accès aux produits alimentaires essentiels pour les ménages vulnérables. Une régulation plus rigoureuse des prix ainsi que des aides ciblées pour atténuer l’impact de l’inflation sur les denrées de base sont également des pistes à explorer.
De plus, promouvoir l’agriculture locale et durable pourrait à terme réduire la dépendance aux importations et stabiliser les prix des aliments.
À travers cette transformation du panier alimentaire, il est évident que la société marocaine est confrontée à une fracture sociétale grandissante. Tandis que certains s’efforcent d’adopter des régimes alimentaires variés, d’autres doivent faire face à des restrictions croissantes, accentuant ainsi les inégalités économiques et territoriales au sein du pays.