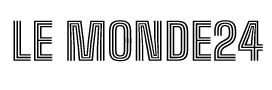Progrès notables dans la lutte contre le VIH au Maroc
Le Maroc a récemment mis en place un nouveau Plan stratégique intégré pour le VIH, les infections sexuellement transmissibles (IST) et l’hépatite virale, qui s’étend de 2024 à 2030. Dans un contexte régional préoccupant, où les cas d’infections augmentent, le pays affiche une réduction impressionnante de 35 % des nouvelles infections au VIH entre 2010 et 2023, selon un rapport d’Frontline AIDS, une alliance internationale d’organisations gouvernementales et non gouvernementales.
Un plan d’action engagé et inclusif
Le Maroc se positionne comme un acteur clé dans la lutte contre le VIH, grâce au soutien d’une initiative renouvelée qui promeut l’engagement des populations clés dans le développement et l’application des politiques de santé. Ce plan favorise une approche inclusive, rendant la réponse nationale plus réactive face aux besoins de la société. La contribution des acteurs de la société civile est cruciale dans cette dynamique, mettant en avant un véritable effort collectif pour améliorer le système de santé.
Le bilan est positivement marquant : aujourd’hui, 78 % des personnes porteuses du VIH connaissent leur statut sérologique, 74 % ont accès à des traitements antirétroviraux (ARV), et 66 % bénéficient d’une suppression virale efficace. Ces chiffres plaident en faveur d’une approche capable d’atteindre les objectifs internationaux d’ici la fin de la décennie.
Financement et infrastructures sanitaires
Le financement des actions menées pour combattre le VIH provient principalement du ministère de la Santé et du Fonds mondial. Les ressources se concentrent en grande partie sur les traitements ARV, tout en renforçant également le budget consacré à la prévention. À noter que près de 70 % de la population marocaine est couverte par une assurance maladie, ce qui facilite l’accès aux soins.
En parallèle, le pays s’est doté d’institutions de monitoring, dont le Conseil national des droits de l’homme, qui soutiennent une Stratégie nationale axée sur les droits de l’homme et la santé. Ces efforts visent à lutter contre la stigmatisation et à améliorer l’accès aux soins. L’Indice de stigmatisation de 2022 a montré des avancées positives par rapport à 2016, atténuant ainsi les préjugés associés au VIH.
Défis persistants dans la réponse à l’épidémie
Malgré ces progrès, des défis subsistent. L’autonomie de la société civile demeure limitée et souvent tributaire de financement extérieur. Les lacunes dans l’évaluation des dépenses publiques compliquent un suivi rigoureux des progrès réalisés. Même si le ministère de la Santé soutient majoritairement les efforts de lutte, des questions de durabilité se posent, nécessitant une plus grande implication du secteur privé.
Par ailleurs, l’accès à la prophylaxie pré-exposition (PrEP) reste insuffisant, en particulier dans les zones rurales, où la sensibilisation aux risques du VIH est faible. Les normes de genre préjudiciables, en plus des variations dans la disponibilité des ARV, des tests de dépistage et des préservatifs, empêchent d’atteindre une couverture adéquate pour contrer la pandémie.
Situation régionale alarmante
À une échelle plus large, l’Alliance a observé une croissance de 116 % des nouvelles infections au VIH au Moyen-Orient et en Afrique du Nord entre 2010 et 2023, avec 22 962 nouveaux cas rapportés en 2023, représentant environ 1,77 % des cas mondiaux. Cela souligne la gravité de la crise de santé publique dans cette région.
Il est également noté que le financement des initiatives de prévention est largement insuffisant, avec seulement 15 % des ressources nécessaires mobilisées pour une réponse adéquate. De plus, la fermeture du bureau d’ONUSIDA dans la région et le manque de coordination entre les agences des Nations Unies, les gouvernements et les réseaux communautaires aggravent le problème, entravant les efforts de lutte efficace contre le VIH.
La nécessité de renforcer les actions, tant au niveau national que régional, est plus pressante que jamais. Les efforts conjugués doivent se concentrer sur l’amélioration de l’accès aux soins, la sensibilisation et la réduction de la stigmatisation pour enfin inverser la tendance actuelle des nouvelles infections.