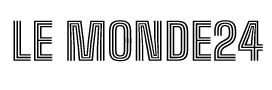Un projet de loi agricole transformé par le Sénat
Le vote du Sénat, qui s’est tenu le 18 février, a été marqué par l’adoption d’un texte sur l’orientation agricole largement amendé. Après une longue période de débats, souvent entravés par la censure gouvernementale, la chambre haute a validé une nouvelle version de ce projet qui se concentre sur la notion de « souveraineté alimentaire ». L’objectif est clair : moderniser le secteur en permettant l’intégration de nouvelles générations d’agriculteurs tout en réduisant certaines contraintes environnementales. Ce texte, révisé par le Sénat, se distingue de celui qui avait été proposé par l’Assemblée nationale au printemps dernier.
Des visions divergentes au sein des deux assemblées
Les députés et sénateurs ont des approches différentes concernant ce projet, qui englobe des thématiques variées telles que la formation, la gestion des haies et le statut des chiens de protection des troupeaux. Une commission mixte paritaire a été prévue pour tenter de parvenir à un consensus en vue d’une adoption rapide, avant l’inauguration du Salon de l’agriculture prochainement.
Un nouvel encadrement de l’agriculture comme intérêt général
Parmi les points saillants salués par la FNSEA, premier syndicat agricole français, le projet de loi élève l’agriculture au statut d' »intérêt général majeur ». Cette mesure vise à orienter les décisions du juge administratif en faveur des projets agricoles, en équilibrant les nécessités de production avec les impératifs environnementaux. Cependant, certains juristes et élus critiquent cette mesure, soulignant que la protection de l’environnement possède une valeur constitutionnelle, tandis que l’intérêt général de l’agriculture n’est qu’une disposition de loi ordinaire.
Le texte renforce également la protection de l’agriculture en l’incluant dans le cadre des « intérêts fondamentaux de la Nation », tel que défini dans le code pénal. Les sénateurs, favorables à cette révision, ont introduit un principe controversé de « non-régression de la souveraineté alimentaire », semblable à l’exigence de non-régression en matière environnementale. Tout en privilégiant une approche pragmatique, le Sénat a retiré plusieurs mentions relatives à la « transition écologique » dans le cadre des politiques agricoles, suggérant plutôt le terme « adaptation ».
Formation et accompagnement : des efforts pour renouveler les générations
Le projet de loi s’attaque à deux enjeux majeurs : attirer de nouvelles recrues dans un secteur confronté à un vieillissement des agriculteurs et adapter les pratiques agricoles face au changement climatique. Pour cela, il aspire à atteindre 400 000 exploitations agricoles d’ici 2035, avec un objectif de 500 000 agriculteurs au sein de ces exploitations. Un nouveau diplôme de niveau bac+3, probablement dénommé « Bachelor agro », pourrait voir le jour, avec la mise en place d’un guichet unique départemental pour accompagner les agriculteurs dans leur installation ou lors d’une transmission de leurs exploitations.
Le texte prévoit également un « diagnostic modulaire », visant à aider les jeunes agriculteurs à prendre la relève des fermes en leur offrant des informations sur la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations. De plus, il pourrait instaurer, d’ici quelques années, une aide pour faciliter la transmission des terres des agriculteurs en fin de carrière.
Dépénalisation et simplification des procédures environnementales
L’un des aspects notables du projet est l’introduction d’une présomption d’urgence dans les litiges relatifs à la construction de réserves d’eau pour l’irrigation, permettant ainsi d’accélérer les délais de traitement. Cette présomption s’appliquera également aux projets de constructions de bâtiments d’élevage, qui sont souvent confrontés à des recours juridiques de la part d’associations écologiques.
Le texte propose une approche mitigée envers les infractions liées à l’environnement. En élargissant considérablement les cas de dépénalisation, il impose des amendes administratives pour les violations non intentionnelles, réduisant ainsi les peines qui étaient appliquées jusqu’à présent. Cette révision a suscité des critiques, notamment de la part des députés de gauche, qui dénoncent une possible banalisation des atteintes à l’environnement.
Avec l’intention de simplifier les démarches administratives, en particulier pour la plantation de haies, le projet cherche à alléger le cadre réglementaire complexe qui entrave souvent les agriculteurs dans leurs initiatives. Ainsi, il sera essentiel de rebâtir un équilibre entre les besoins agricoles et les impératifs de protection de l’environnement.