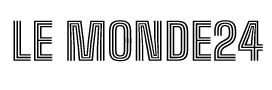Une crise profonde dans les montagnes du Haut Atlas
Dans les majestueuses montagnes du Haut Atlas, une crise socio-économique se manifeste par l’effondrement de la production agricole et la dégradation des écosystèmes locaux. Les agriculteurs, lassés par des conditions de plus en plus difficiles, se retrouvent dans une situation précaire, poussés à abandonner leurs méthodes agricoles traditionnelles. Un récent rapport a révélé que cette détérioration est le résultat d’un exode rural croissant et d’un manque de politiques adaptées pour soutenir l’agriculture traditionnelle, points que traitent en détail des chercheurs dans une étude publiée dans le magazine Scientific Reports.
Une étude révélatrice
Intitulée « La transformation urbaine-rurale façonne l’agriculture oasienne dans les montagnes du Haut Atlas marocain », cette étude a été réalisée par Youness Boubou, Kira Fastner et Andreas Burkert. Les chercheurs ont mis en exergue les modifications profondes des pratiques agricoles et des moyens de subsistance des habitants de cette région. Cette transformation est principalement alimentée par l’intensification des interactions entre les zones rurales et urbaines, ainsi que par l’émergence de nouvelles opportunités économiques en milieu urbain.
Pour mener à bien leur investigation, les chercheurs ont interrogé 45 agriculteurs de la localité de Tizi N’Oucheg, mettant en lumière des aspects essentiels tels que la composition des ménages, les migrations, les sources de revenus, les droits de propriété, ainsi que les méthodes agricoles.
Des chiffres alarmants
Les résultats de l’enquête ont révélé une réduction préoccupante de la superficie cultivée. En effet, celle-ci a chuté de 13 hectares en 1967 à seulement 6,8 hectares en 2022, une diminution de près de 48 %. La période de 1972 à 1984 a été marquée par une chute particulièrement prononcée. En parallèle, près de 68 % des agriculteurs ont constaté une baisse d’un tiers de leur production agricole au cours des deux dernières décennies.
Les causes de cette situation sont multiples. Le manque d’eau pour l’irrigation a été cité par 52 % des agriculteurs, tandis que 47 % évoquent une pénurie de main-d’œuvre au sein des ménages. La fragmentation des terres, souvent due à l’héritage, a également contribué à réduire la taille des exploitations, les rendant moins viables économiquement. De plus, les activités d’élevage ont connu un net déclin. À Tachmecht, sur 21 étables recensées, seulement 10 continuent à fonctionner, ce qui entraîne une diminution de la production de nourriture pour les bétails et, par extension, de lait pour les jeunes animaux.
Une urbanisation croissante
Dans le même temps, la superficie bâtie a quadruplé au cours des dernières décennies. La construction d’une route, certes en mauvais état, a facilité l’accès à Tizi N’Oucheg, entraînant des transformations considérables dans la région. Le développement de cette oasis, en lien avec la vallée de l’Ourika, a ouvert des perspectives touristiques prometteuses, tout en attirant des investissements d’organisations non lucratives et des remises de la part des villageois émigrés. Ces apports ont permis la construction de nouvelles habitations en béton, l’amélioration des infrastructures éducatives et récréatives, ainsi que le développement d’une offre d’hébergement touristique.
Une évolution des modes de vie
Au fil des ans, le mode de vie des habitants de l’oasis a évolué. Les résidents ont progressivement abandonné un modèle d’agriculture de subsistance pour diversifier leurs activités. Selon l’étude, 87 % des ménages interrogés comptent désormais un membre, généralement le chef de famille ou un fils adulte, travaillant à temps plein ou saisonnier à l’extérieur de l’oasis. Ces emplois, souvent trouvés dans la construction, le commerce de détail, le tourisme et la restauration, ne nécessitent pas de qualifications particulières et représentent plus de 50 % des revenus des ménages.
Les agriculteurs ont mis en avant que l’émigration a exacerbé le manque de main-d’œuvre, exacerbant ainsi la réduction des surfaces cultivées. De plus, le changement climatique, avec une diminution des précipitations, a été identifié par de nombreux agriculteurs comme un facteur clé influant de manière significative sur leurs pratiques agricoles et l’utilisation des terres.
Cette situation complexe pose des défis considérables pour la région, impliquant une réflexion sur les moyens de soutenir les agriculteurs tout en tenant compte des nouvelles dynamiques économiques qui se dessinent.